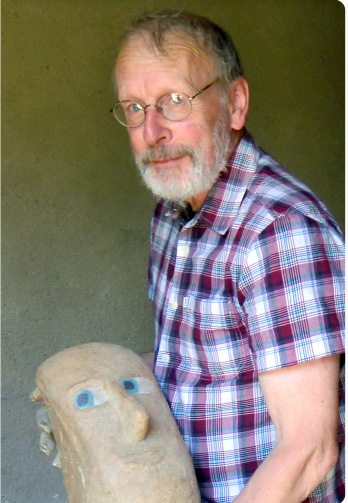guillaume céramiques



illusions
Par Nicole CrestouJean Guillaume donnes à ses sculptures un minimum d'éléments permettant de générer une histoire? Elles sont donc figuratives...
Lire la suite
la recherche d'autres mondes
Par Jean-Francois LeratAprès 1990 avec ma mère, Jacqueline Lerat, j'allais chercher les terres qu'elle conservait dans son ancien atelier de La Borne...
Lire la suiteGrès
Ce que je recherche, c'est un aspect minéral, apporté par la flamme de la cuisson au bois sur les engobes.
Jean GuillaumeSculptures céramiques récentes
































































Voir davantage
Curriculum vitae
Jean Guillaume, né en 1949 à Salon de Provence
Formation, Prix et distinctions, Parcours professionnel, Bibliographie
Principales expositions
Expositions collectives, expositions personnelles
Plus d'informations
Contacter